[RAPPORT] Transparence de la vie publique, lutte contre la corruption : quel bilan du quinquennat 2017-2022 ?
Que reste-t-il de la « République exemplaire » promise par le candidat Emmanuel Macron ? Transparency France dresse le bilan de cinq ans de réformes, mais aussi d’affaires, d’errements et de renoncements.
Entamée à l’ombre de « l’affaire Fillon » et inaugurée par des déclarations du président élu annonçant vouloir faire de la moralisation de la vie publique le socle son action, que reste-t-il de la présidence « exemplaire » promise par Emmanuel Macron durant sa campagne ? Transparency France fait le bilan du quinquennat en matière de probité et de lutte contre la corruption. Cinq années rythmées par les réformes, mais aussi par les affaires et la tentation de limiter les contre-pouvoirs. Un bilan finalement bien maigre, au regard des ambitions affichées, des attentes citoyennes et du coût de la corruption, révélé au rythme des leaks et des enquêtes de la presse d’investigation.
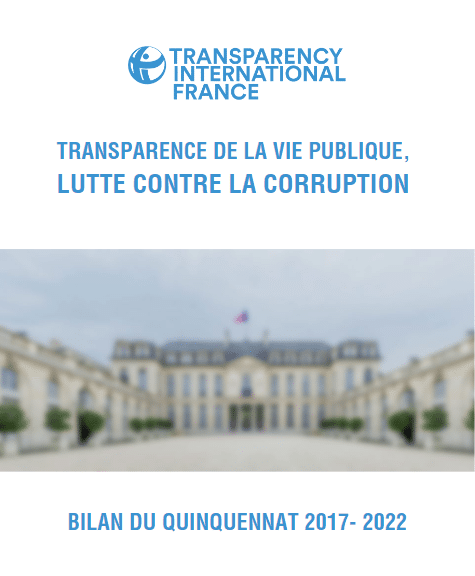
Au-delà de ces engagements, l’examen attentif des réformes adoptées durant la législature qui s’achève le 24 février 2022 offre d’autres indicateurs de la volonté politique de lutter contre la corruption. Là encore, le bilan du quinquennat apparaît mitigé. Si des avancées certaines, comme le renforcement du contrôle des mobilités public / privé des décideurs publics, l’ouverture au public des registres sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, la création d’un mécanisme de restitution des biens mal acquis ou l’adoption d’une loi ambitieuse de protection des lanceurs d’alerte ont été enregistrées, des reculs et des renoncements viennent tempérer le bilan de ces cinq ans d’exercice du pouvoir.
Comme dans bien d’autres pays, la crise sanitaire liée à la COVID 19 a fragilisé l’Etat de droit et réduit l’espace de débat démocratique en France. Un nombre important de décisions restreignant les libertés publiques ont été prises dans le cadre très restreint et très opaque du Conseil de défense sanitaire, sans réel débat parlementaire. Mais les atteintes au débat public et au rôle des contre-pouvoirs en France ne trouvent pas leur origine dans le seul contexte sanitaire mondial. La loi confortant “le respect des principes de la République”, votée à l’été 2021, contient des restrictions dangereuses pour la liberté d’association avec notamment la conditionnalité des subventions publiques au respect d’un critère flou de respect de « l’ordre public ». De la même manière, les attaques portées par l’exécutif contre le Parquet National Financier et l’association Anticor, ou encore le nombre important d’affaires d’atteintes à la probité touchant des membres de Gouvernement et, le maintien en fonction de plusieurs d’entre eux, pourtant mis en examen, illustrent bien mal l’ambition initiale de « la République exemplaire » promise lors de la campagne de 2017.
Autres signes du manque de volonté politique de l’exécutif sous ce quinquennat de faire de la transparence de la vie publique une priorité : le refus persistant d’une révision des dispositions de la loi Sapin II en matière de transparence du lobbying. Malgré un consensus toujours plus large sur la nécessaire révision du décret d’application concernant le répertoire des représentants d’intérêts afin qu’il reflète plus précisément les relations entre ces derniers et les décideurs publics, aucune amélioration n’a été apportée sur ce point au cours des cinq dernières années.
Cette appréciation du quinquennat en matière de transparence et de lutte contre la corruption se reflète par ailleurs dans le classement de la France dans l’Indice de Perception de la Corruption 2021 de Transparency International. Classée 22e sur 180 pays, la France n’a gagné qu’une place et n’a amélioré son score que d’un point pendant les 5 ans du mandat présidentiel. Un sursaut est nécessaire.
POUR ALLER PLUS LOIN
NOS 11 PROPOSITIONS AUX CANDIDATS A LA PRESIDENTIELLE POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
